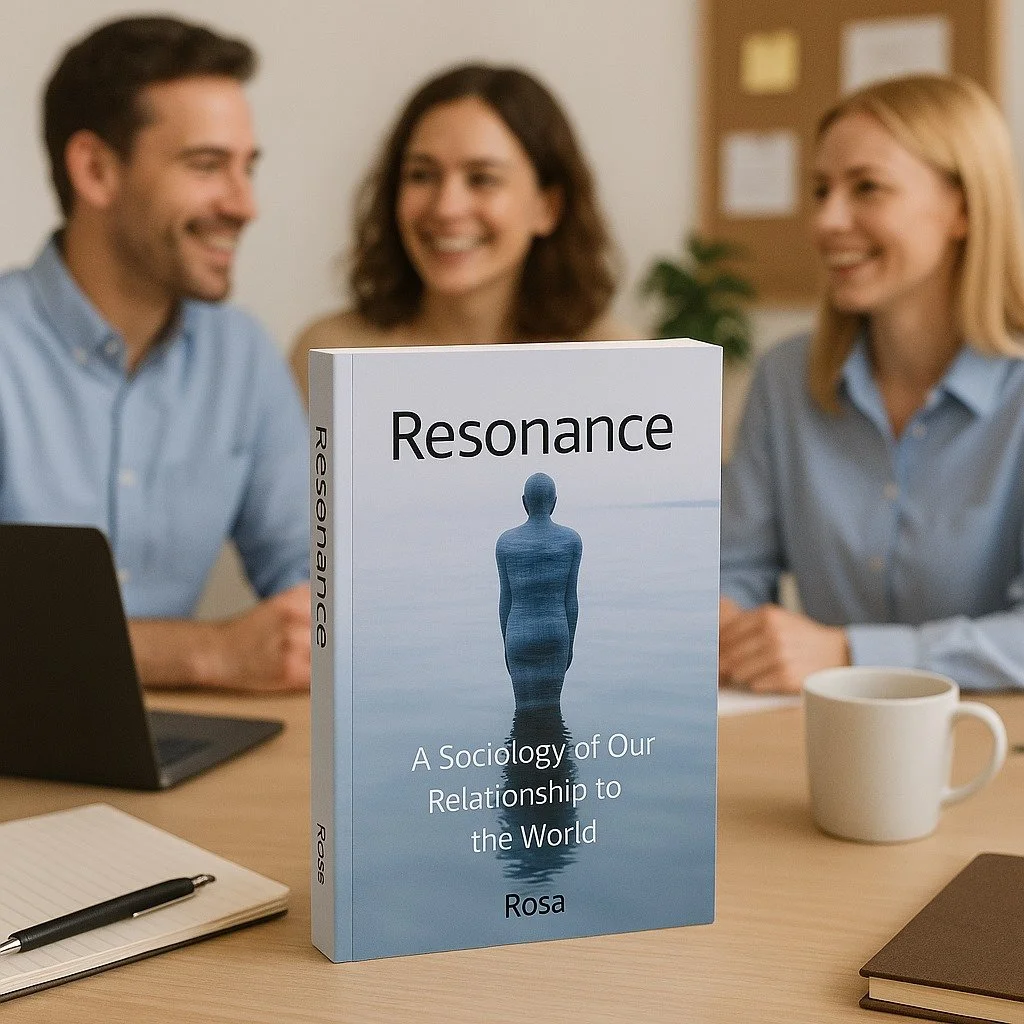Le chœur de la transformation : leadership et résonance
Lecture de Résonance, Une sociologie de la relation au monde de Hartmut Rosa
Ceci est le deuxième article de la série « Pour un leadership qui résonne »
Lire la partie 1 : Le silence du monde, introduction à la résonance - Lire la partie 3 : Brussels Airlines: créer de la résonance sur le terrain
C'est un peu ironique d'écrire sur le leadership idéal dans la vie professionnelle, dans la mesure où tant de citoyens à travers le monde semblent attirés par son avatar dégénéré et toxique dans la vie publique.
Notre attirance pour un "grand homme" plein de lui-même, cruel et corrompu, reste collée à la psyché humaine tel un scotch dont on n'arrive pas à se débarrasser, siècle après siècle.
On continue de choisir des types de cette espèce, de les placer aux fonctions les plus hautes, éventuellement de s'en repentir au vu des dégâts qu'ils causent, pour recommencer une génération après ou même encore plus tôt. C'est assez désespérant. Mais désespérer il ne faut pas, comme nous y invite le philosophe Hartmut Rosa dans son livre "Résonance : une sociologie de la relation au monde".
Dans un article précédent, j'ai tenté de résumer la notion de résonance selon Rosa – cette interaction de qualité au monde, qui nous émeut, nous façonne et nous rend libres – et ce qui m’inspire dans cette idée.
Aujourd'hui, je voudrais rapprocher la résonance telle que définie par Rosa et la pratique du leadership tel que je l'envisage. Cela peut être utile à celles et ceux qui s'intéressent au travail, et en particulier pour les hommes et femmes agissant en entreprise en tant que chefs d'équipe, responsables communication, professionnels des ressources humaines, cadres supérieurs, professionnels du changement… et de façon générale, toute personne exposée à l'expérience professionnelle d’autres individus ou qui la façonnent par leur leadership.
Le leadership est encore trop souvent perçu comme une compétence (ou combinaison de compétences) individuelle. Je pense que c’est faux.
Le leadership est une capacité collective qui émerge d'un groupe de personnes diverses, connectées en réseau, agissant librement et de concert au service d'une intention commune. C’est pourquoi je tends à l’appeler leadership relationnel, comme dans le sous-titre de Dare to Un-Lead.
En quoi ce leadership peut-il fabriquer de la résonance ?
Pourquoi le ferait-il ?
Quelles sont les leçons à tirer, mais aussi les pièges à éviter, pour les personnes désireuses de questionner leur propre leadership ou celui des autres en vue de l'améliorer ?
J’analyserai ces questions en 3 temps, en passant assez vite sur la première : pourquoi le leadership « classique » nuit à la résonance – allez directement à la partie suivante si le constat vous est familier. Nous nous pencherons ensuite sur une série de fausses bonnes idées, puis sur des pratiques plus prometteuses.
1. Organisations muettes : l'érosion de la résonance dans le leadership actuel
Les pratiques de leadership habituelles, souvent inconscientes, empêchent activement la résonance. La crise silencieuse des organisations contemporaines dont a parlé le post précédent poussent les individus et le collectif dans un état d'aliénation où le travail ne "parle" plus aux gens.
Ceci transparaît dans les taux d'engagement des employés, obstinément bas à travers le monde : 23 % en 2024 ; 30 % seulement des managers déclarent se sentir engagés –d’ailleurs, les gens ne veulent plus être managers ! L’épidémie mondiale de burnout atteint des proportions inégalées (le burnout étant un état dans lequel « tous les axes de résonance sont devenus muets et sourds », selon Rosa), coûtant des milliards aux entreprises en perte de productivité et encore plus à nous tous en violence sociale.
Certes, le système capitaliste extractif et l'accélération du monde y sont pour beaucoup ; mais au sein des organisations, plusieurs phénomènes jouent à fond contre la résonance.
Contrôle, anxiété et réification des individus
La rigidification et l'automatisation des processus de travail donnent aux salariés le sentiment (souvent à juste titre) que leur capacité d'action et leur potentiel d'impact unique sont érodés. Qui n’a pas été frappé par les travaux de David Graeber sur les "jobs à la con" ? Aujourd’hui, en plus de l’effroi de ne servir à rien, les travailleurs craignent d’être purement remplacés par l’IA. Or « la peur et l'anxiété sont des ‘tueuses de résonance’ par excellence, car quand elles envahissent le sujet, elles l’empêchent de s'ouvrir au monde, de s'y connecter et de s'y impliquer », écrit Rosa.
Ce sentiment d'inutilité et d'aliénation contribue à alimenter la rhétorique populiste. Elle est exacerbée par un management défaillant, où des leaders peu sûrs d'eux ou sur-pressurisés exigent obéissance, alignement, ordre, certitude, rapidité et exécution, au lieu d'inviter à la participation.
Comme l'explique Rosa, "L'erreur de la modernité réside dans la confusion entre un concept d'auto-efficacité muet, orienté vers les résultats et la domination, avec l'expérience d'une forme d'auto-efficacité résonante, influente, orientée vers les processus et les réponses".
Cela conduit souvent à la "réification de soi et des autres". J'ai vu un million de fois à quel point il est facile de déshumaniser les autres au travail et de tomber dans des relations purement transactionnelles avec collègues, membres de l'équipe et managers.
Segmentation en silos et atomisation sociale
Le travail entrave souvent ce que Rosa appelle la "résonance horizontale" – des relations significatives avec d'autres êtres humains.
En raison de leur taille, d’habitudes de travail ancrées ou simplement d'un manque d'imagination, les organisations privilégient souvent la segmentation interne au développement de réseaux internes dynamiques. La segmentation peut être horizontale (par niveau de responsabilité) ou verticale (par fonction) et ce n’est pas la quantité d’équipes projets ou de réseaux affinitaires (souvent, opportunité de segmentation supplémentaire) qui y changeront quelque chose. Les dirigeants sous-estiment l'impact négatif des inégalités d’accès à l’information et de statut dans des modes opératoires encore très hiérarchiques.
Avec la mode de la « raison d’être », les entreprises se sont mises à clamer comment elles « changent le monde », tentant de mobiliser leurs salariés autour d’un noble objectif, mais n’allant souvent pas plus loin que le simple "purpose-washing" de leur activité. Cultiver un véritable sentiment collectif et le soutien mutuel nécessaires à une connexion authentique reste un exercice compliqué.
Laisser les individus se sentir déconnectés et remplaçables, vivant une "expérience atomisée et monadique" au travail, est extrêmement préjudiciable à la "polyphonie productive" qu'une organisation pourrait autrement atteindre. Alors que faire ? D’abord, se méfier des fausses bonnes idées.
2. Les fausses résonances : illusions du management contemporain
Certaines tendances en vogue dans les organisations, bien qu’a priori positives, ne permettent pas une résonance authentique. Elles peuvent même en perpétuer l’érosion.
Ce sont des "fausses bonnes idées" – des tentatives de créer une connexion qui, selon les termes de Rosa, ratent leur cible ou deviennent même des "tueuses de résonance" pathologiques.
La stimulation émotionnelle comme substitut à la connexion
L'une de ces illusions est la simple stimulation émotionnelle des salariés.
Les entreprises investissent massivement dans des programmes de bien-être, une communication jouant sur les émotions, des bureaux à l'esthétique soignée, dans le but de créer des "bonnes vibrations".
Pourtant, comme Rosa nous en avertit, "Parce qu'il n'y a pas de connexion qui permette l'auto-efficacité, il y a toujours un risque que les consommateurs [ou les salariés traités comme des consommateurs] soient simplement stimulés émotionnellement plutôt que véritablement affectés".
Cette forme d'"esthétisation, de psychologisation et d'émotionnalisation" du travail […] peut créer un attrait superficiel sans véritable profondeur.
La résonance, nous rappelle Rosa, "n'est pas un état émotionnel, mais un mode de relation neutre quant au contenu émotionnel".
Sans de véritables voies pour une influence active et une transformation mutuelle, de tels efforts restent "muets", ne parvenant pas à allumer cette "forme de contact énergétiquement chargée" entre soi et le monde.
La compétition et l'attrait de la maximisation
Une autre pratique répandue qui sape la résonance est l’incessante promotion de la compétition et l'appel à maximiser ses propres intérêts économiques ou statutaires. « On ne fait pas cela ici ! Nous prônons la collaboration » entends-je parfois chez mes clients. Alors, pourquoi conservez-vous ces systèmes de gestion de la performance qui projettent précisément le message inverse ?
Bien que cela semble stimuler la performance, Rosa déclare explicitement que "la compétition et la résonance sont donc deux attitudes incompatibles envers le monde".
Lorsque les individus sont principalement motivés par "le désir de maximiser un bénéfice personnel économique, statutaire, ou autre", leurs actions sont éloignées de la "quête de résonance et du refus de l'aliénation en tant que modes de relation" qui constituent "les moteurs fondamentaux du comportement humain".
Cette orientation hyper-compétitive favorise une aliénation dispositionnelle, transformant les collègues en rivaux plutôt qu'en partenaires dans une entreprise partagée et réceptive.
Soyez vous-même, et soyons tous d’accord
Troisièmement, la demande contemporaine d'une pleine ouverture, de transparence et même d'une authenticité brute au travail – souvent présentée comme "venez comme vous êtes" ou la culture de la "sécurité psychologique" – peut paradoxalement entraver la résonance.
Bien que positives a priori, ces tendances peuvent encourager la vulnérabilité forcée, la démonstration performative des émotions, ou la sur-simplification de l'identité sociale de l'individu autour d'une "seule histoire".
La vision nuancée de Rosa nous rappelle que "les relations résonantes exigent que le sujet et le monde soient suffisamment « fermés » ou cohérents pour chacun parler de leur propre voix, tout en restant suffisamment ouverts pour être affectés ou atteints l'un par l'autre".
Par ailleurs, la quête répandue d'accord, de consensus et d'un climat social apaisé au travail (pouvant mener au musellement des syndicats ou des voix discordantes) est susceptible de générer une "chambre d'écho" pathologique.
Or, pour qu’il y ait résonance authentique, il faut la tension de la différence et de la contradiction.
La quantification de tout
Enfin, la quantification généralisée dans les organisations modernes, motivée par une obsession de la mesure et de la donnée, nuit activement à la résonance.
Bien que prometteuse d'efficacité et d'une perspective objective, cette tendance transforme les relations qualitatives en métriques mesurables.
Comme Rosa l'observe, "les efforts pour garantir la qualité en particulier – même et surtout lorsqu'ils témoignent d'un sens de la qualité des relations [...] sont souvent des passerelles vers la pire transformation de relations résonnantes en relations muettes". J’ai vu ce phénomène de près et à de nombreuses reprises lors de mon travail en entreprise ; certaines anecdotes sont racontées dans mon livre.
La "compulsion bureaucratique à produire des documents [...], à mesurer et quantifier chaque réalisation et même chaque idée, rend la vie infernale aux travailleurs [...]. Elle les empêche de faire leur travail correctement et bien".
Lorsque tout est quantifié et optimisé, l'"inaccessibilité" inhérente et la nature spontanée de la vraie résonance sont détruites, réduisant la richesse de l'interaction humaine à une série de points de données.
Cela nous pousse davantage vers une "relation muette au monde", ne voyant les gens que comme des ressources à exploiter, plutôt que comme des partenaires dans un échange dynamique et impactant.
3. Faire chanter le travail : le leadership de la résonance
Comment le leadership peut-il cultiver activement la résonance au sein des organisations ?
Ce n'est pas seulement une compétence "douce" ou une tendance passagère ; c'est un impératif social et, de plus en plus, une stratégie commerciale essentielle.
Rosa note que "les employeurs ont un intérêt primordial pour cette sensibilité à la résonance ; ils exigent des travailleurs qui sont socialement empathiques, dotés d'un sens aigu des exigences de leurs collègues et de leurs clients, des ambiances et des atmosphères, et qui, de surcroît, sont capables d'appliquer pleinement leurs impulsions créatives et inspirantes à leur travail".
Il ajoute que "les groupes de projets et le travail en équipe, qui sont devenus dominants dans de nombreux domaines, exigent des structures de personnalité résonantes".
Quelles pratiques de leadership permettent de libérer ce potentiel humain ?
Favoriser « l’auto-efficacité » active
Le leadership résonant crée les conditions et la possibilité pour les individus de pratiquer une véritable « auto-efficacité » – ou sentiment d’efficacité personnelle, le côté actif de leur relation au monde.
Il favorise un environnement où les employés peuvent véritablement "générer de la résonance". C'est ce que j'ai à l'esprit lorsque je travaille sur des projets d'engagement : l'engagement compris comme "Donner envie aux gens de prendre l'initiative et de créer", pas comme le "Êtes-vous satisfait.e ?" généralement mesuré par les enquêtes d'engagement des entreprises.
Rosa cite le psychologue canadien Albert Bandura, père du concept d'auto-efficacité en 1977. Selon Bandura, les individus, architectes partiels de leur propre destinée, contribuent causalement à leur fonctionnement psychosocial par des mécanismes d’agentivité personnelle (personal agency) dont le fondement est la croyance d’efficacité personnelle : « la croyance des gens dans leurs capacités à agir de façon à maîtriser les événements qui affectent leurs existences ». Cette croyance d’efficacité influence la façon dont on perçoit, pense, se motive, se comporte.
Quand on est nombreux à ressentir cette auto-efficacité, il se produit ce sentiment d'auto-efficacité collective qui propulse les organisations vers l'avant.
Pour cela, il faut faire de l’organisation ou au moins de l’équipe un espace auquel les individus contribuent, grâce à leurs talents particuliers, mais aussi dans lequel ils peuvent faire l’expérience de "l'interdépendance, et de la réciprocité qui émerge de ce processus". Un espace dans lequel ils perçoivent leur impact et le « chant » de leur travail.
Il s'agit de passer d’un statut de collaborateur managé à celui de co-façonneur du travail – quel que soit le niveau hiérarchique au sein de l'organisation.
Cultiver la relation et le sens partagé
Le leadership de la résonance combat activement la segmentation et l'atomisation sociale en favorisant l’interrelation et la possibilité pour les gens de faire sens ensemble de ce qui arrive à eux-mêmes et à leur organisation.
Il construit de façon intentionnelle des ponts qui transcendent les divisions hiérarchiques et fonctionnelles.
Il ne s'agit pas d'une harmonie forcée, mais de la création d'un environnement où un "espace commun, interpersonnel de sens" peut émerger.
Rosa souligne que "la capacité d'empathie mutuelle, de compréhension et d'adoption d'autres perspectives est importante non seulement pour le développement des qualités socio-morales, mais aussi pour l'apprentissage, la pensée et l'action en général".
C’est cela que les leaders facilitent, en valorisant la diversité des perspectives, en encourageant un véritable engagement, en permettant la "contradiction" que Rosa considère comme essentielle à la vraie résonance, plutôt que de tenter de la supprimer par un faux consensus.
Ils et elles cultivent un contexte où les gens sont "hyper-accordés les uns aux autres émotionnellement" et peuvent véritablement "entrer dans une relation réactive" avec autrui.
Amplifier la voix et les histoires
Peut-être plus fondamentalement, le leadership porteur de résonance s’efforce d’amplifier toutes les voix, contribuant à l’édification d’histoires qui soutiennent le collectif.
Rosa souligne que "le premier et fondamental organe par lequel nous entrons en relation réactive avec le monde et faisons en sorte que le monde nous réponde est la voix".
Les leaders ont la responsabilité de créer canaux et culture où chaque individu a le sentiment de pouvoir s'exprimer, d'être entendu et de véritablement contribuer à la "polyphonie productive" de l'organisation.
Au-delà des voix individuelles, c'est à travers les récits partagés que "les êtres humains génèrent de fortes résonances empathiques".
Les leaders ne sont donc plus les seules sources d'histoires, ni les seuls conteurs. Ils deviennent, en plus, des curateurs et des témoins, comprenant que "les communautés sociales sont avant tout des communautés de narration, possédant un répertoire commun d'histoires produisant et dirigeant la résonance".
En favorisant une polyphonie dynamique de voix et de récits, le leadership nous rapproche de la "promesse fondamentale de la modernité... le grand espoir d'un monde qui chante" à travers nos organisations.
* * *
Pour bâtir des organisations résonantes, performantes parce que le travail y "chante" véritablement, il nous faut passer d'un leadership traditionnel et extractif à des pratiques qui amplifient la capacité d'agir, favorisent une véritable relation, et cultivent une polyphonie dynamique de voix.
Dans la dernière partie de cette série, je partagerai une application concrète et pratique de ces principes : le Community Studio, une approche conçue et mise en œuvre pour aider les organisations à construire ces connexions vitales et à donner vie à la promesse de résonance.